Satigui, le sorcier !
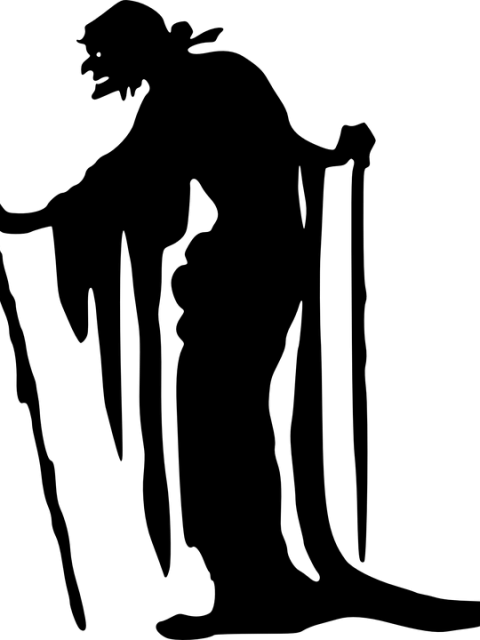
Naître et grandir au village toute l’enfance et une partie de mon adolescence n’ont jamais réussi à émousser mon esprit cartésien acquis sans doute à l’école française. Mon raisonnement est quasi-systématiquement guidé par les principes de la science.
J’ai donc fichtrement du mal à croire à la sorcellerie, contrairement à une bonne partie de mes compatriotes surtout les analphabètes et les villageois.
Ceux-ci sont convaincus que certaines personnes -les sorciers- disposent des pouvoirs maléfiques capables de détruire un individu soit en le ruinant économiquement, soit en l’éloignant volontairement de son pays, voire en le tuant. Dans ce dernier cas, on dit « qu’on l’a mangé ». Selon ces croyances, les sorciers cannibales seraient capables à la nuit tombée de se transformer en animal (hibou, serpent, hyène, abeille…) pour jeter un sort sur leurs malheureuses cibles.
Ainsi, à chaque fois que je m’apprête à aller au village, on multiplie les conseils de précaution : « n’annonce pas ta venue, ne viens surtout pas avec une voiture, ne sers pas la main d’un tel, ne mange jamais chez cette vieille, évite de t’assoir à tel endroit, etc. »
Sans tomber dans la provocation, je n’ai jamais suivi tous ces conseils à la lettre. Même si je ne tente jamais le…sorcier, je ne vois pas comment quelqu’un peut être capable de se transformer en oiseau pour aller « manger » un être humain. D’ailleurs, en admettant que ce soit possible, pourquoi alors les sorciers du village ne sont pas les plus aisés ? Pourquoi n’ont-ils pas plus d’embonpoint ? Pourquoi tous les villageois ont la peau rugueuse, les mains ravagées par des cals, la démarche mal assurée à cause du dur labeur ?
À chaque fois, on me rétorque « c’est parce que tu n’es pas sorcier, tu ne connais pas leur monde. Tu es ignorant de leur science occulte. »
Alors, cette fois j’ai voulu savoir moi-même. Comme pour les chasseurs de phénomènes paranormaux dans les émissions télé, j’ai tenu à vérifier la véracité ou non de ma conviction que la sorcellerie n’existe pas ou en tout cas un être humain ne peut pas se muer en animal de manière réversible.
Je me suis dit que la meilleure manière de le faire est de pénétrer le monde de la sorcellerie si celle-ci existe. J’ai donc profité de mon récent séjour au village pour me rapprocher du vieillard considéré comme le plus grand sorcier de la contrée: « Satigui Barry ».
Après plusieurs jours de contacts nocturnes réguliers et dans la plus grande discrétion, j’ai réussi à convaincre le vieil homme que je voulais faire un petit stage pour apprendre des « choses cachées » qu’on lui prête de détenir. Il a fini par accepter. La découverte que j’ai faite à travers cette expérience inédite que je compte partager avec vous dans les prochains jours, dépasse l’imagination !
C’est donc au bout de plusieurs jours de conciliabules menés dans le plus grand secret que je réussis à convaincre le « redoutable sorcier » Satigui Barry, de m’apprendre un peu de « sa science occulte ». Pour faire fléchir le vieil homme, il fallait tout d’abord le convaincre de ma détermination et de mon courage inébranlable à aller jusqu’au bout, puisque « jeune homme », me répétait-il, « vous vous engagez sur un chemin redoutable. L’aventure que vous entreprenez vous marquera à jamais et sachez que la transformation que vous allez subir sera irréversible », insista-t-il.
« Sörö (grand-père) » lui ai-je répondu, « je suis tout à fait conscient des risques que je prends en apprenant les secrets de la vie, mais je vous rassure de ma détermination à aller jusqu’au bout. Ma décision est prise et je ne compte pas reculer ». Pour être tout à fait honnête, en disant ça j’avais un peu d’appréhension car je pensais à ma petite famille, à mon épouse en particulier que je n’ai pas consultée avant de prendre cette décision lourde de sens.
Ma détermination venait moins d’une « soif de sang » que celle de me convaincre moi-même de l’inexistence de certains pouvoirs surnaturels que l’on prête aux sorciers. J’espérais, au plus profond de moi, que c’est totalement faux et que mon expérience me confortera définitivement dans ma conviction que la plupart des pouvoirs maléfiques attribués à certaines personnes relèvent exclusivement de la stigmatisation. C’est cette envie pressante de découverte qui me galvanisait et me procurait un courage dont je me sentais jusqu’ici incapable.
Si par la parole, je réussis à convaincre le Vieux Satigui, il fallait en faire bien plus. Le Vieux n’était pas dupe. En homme expérimenté, il me dit ouvertement que pour lui prouver mon sérieux, il allait me faire subir plusieurs épreuves au bout desquelles il s’engageait à me transmettre ce qu’il savait, à condition de les réussir bien évidement. Je lui donnai mon accord sans frémir, ignorant complètement ce qui m’attendait.
Mais avant de subir ces tests de courage et d’engagement, « l’Invincible » comme Satigui Barry m’intima de l’appeler dorénavant me promettant de m’expliquer ultérieurement d’où lui venait ce surnom, « l’Invincible » me proposa donc de discuter pour ainsi dire « des frais de scolarité »! Une de mes certitudes venait ainsi de tomber: je croyais, peut-être naïvement, que l’apprentissage de ces secrets les plus plus gardés se faisait gracieusement. Je pensais que la science occulte, si tant est qu’elle existait, se transmettait de manière naturelle, en tout cas de façon désintéressé. Erreur.
« l’Invincible » m’expliqua qu’il fallait payer. Le paiement était échelonné en trois tranches: les frais d’inscription suivis d’un premier acompte après la réussite de l’une des épreuves, puis le troisième versement à la fin de la formation. «Combien coûte chaque paiement et quel est le montant total ? » m’empressai-je de lui demander redoutant l’annonce d’un montant exorbitant que je ne possède pas.
De son glaçant sourire édenté, le vieil homme me fixa dans les yeux et me dit ceci: « tous les paiements se feront en nature. Ils seront frais et saignants » ajouta-t-il l’oeil pétillant, la lèvre inférieure frémissante. Une décharge électrique parcourut ma colonne vertébrale.
Comme depuis notre premier contact pour parler de ce sujet ultra-confidentiel, la conversation entre Satigui « l’Invincible » et moi avait lieu dans sa maison, à une heure tardive.
Sa maison était constituée d’une petite case au toit de chaume isolée du reste des concessions où personne n’osait plus entrer depuis bien longtemps. Satigui faisait peur. Plus qu’une simple crainte, « Satigui le sorcier » comme on le surnommait, suscitait l’effroi au point que l’on évoquait son nom pour calmer les enfants récalcitrants: « si tu ne te tais pas, Soro Satigui viendra te chercher pendant la nuit ». Et le garnement la bouclait immédiatement.
Le vieux était au courant de la médisance des villageois à son encontre, tout comme la terreur qu’il suscitait. Il s’en fichait. Veuf depuis près de dix ans, le vieil homme vivait seul refusant catégoriquement de se remarier après la mort tragique de sa seconde épouse.
Il avait perdu son unique fils alors que celui-ci était âgé de seulement une vingtaine d’années. « Un beau gosse » se remémorait-on dans le village. Il s’appelait Oury. Le jeune homme avait trouvé la mort dans le champ de riz de son père qu’il surveillait contre les animaux chapardeurs comme les vervets, ces petits singes arboricoles à l’agilité étonnante et qui sont particulièrement néfastes pour le riz arrivé à maturité.
Pour avoir une vue panoramique du champ, on construisait une sorte de guérite à l’aide de rondins de bois montés sur quatre piquets. Le surveillant se perchait là-dessus pour chasser les animaux nuisibles en faisant du bruit ou en se servant d’une fronde pour lancer vigoureusement des pierres. C’est ce que faisait Oury ce jour-là lorsqu’il chuta de la guérite et s’empala sur une souche pointue qui l’éviscéra mettant tous ses intestins dehors !
Trente ans après cette scène macabre sur laquelle tomba son père le premier, on en parlait encore dans toute la contrée avec circonspection. On continuait à supputer que le vieux Satigui n’était pas innocent dans cette mort tragique de son unique fils…
Sa première femme quant à elle était décédée à l’âge de 60 ans d’une « mort naturelle » disait-on. Tout le contraire de la seconde épouse, Hawa, la maman du malheureux Oury. On la décrivait comme une femme à la beauté divine, généreuse et d’une grande discrétion. La mort de son fils unique la bouleversa au point qu’elle frôla la dépression mentale. Son propre destin n’en fut pas moins tragique quelques années plus tard.
C’était une fin de journée éprouvante pour Hawa. Rentrée du champ avec un fagot de bois morts en équilibre sur la tête, elle se hâtait de happer un seau pour aller chercher de l’eau au marigot avant le coucher du soleil. Son mari Satigui se morfondait dans son hamac tendu entre deux piquets en attendant le dîner qui n’était pas prêt d’être servi, Hawa devant piler le riz et faire la cuisine à son retour du marigot.
Celui-ci se situait à l’orée du village dans une vallée encaissée que l’on accédait en suivant un étroit sentier creusé dans la roche. La tête de source était protégée par un épais couvert végétal si luxuriant qu’on avait l’impression qu’il y faisait nuit même à midi. L’endroit dégageait un air sinistre, personne n’osait s’y attarder plus que de raison.
Hawa avait rempli son seau, s’était remise sur le chemin du retour lorsqu’elle aperçut une étrange forme noire dressée sur la route. Elle se pencha légèrement pour distinguer ce que c’était dans la pénombre. C’est à ce moment précis qu’elle sentit la violente morsure du cobra sur son mollet gauche. Elle poussa un cri effroyable, jeta le seau d’eau et se mit à courir vers le village. Mais à peine 200 mètres plus loin, elle s’écroula, ne voyant plus rien sur sa route. Le venin du serpent avait atteint son système nerveux et ses organes vitaux. Elle devint rapidement paralysée. Transportée à la maison par des hommes alertés par ses cris, elle rendit l’âme au petit matin plongeant tout le village dans une grande tristesse mêlée de détresse.
Quelque temps après cette troisième disparition autour de Satigui, les langues se délièrent. Comme pour sa première femme et son fils unique, on l’accusait d’être derrière la mort de Hawa qui avait affligé tout le village tant elle était appréciée pour ses exceptionnelles qualités humaines.
Beaucoup se demandaient pourquoi il l’avait « mangée », selon l’expression consacrée, alors qu’il l’aimait plus que tout, plus que même son défunt fils Oury « sacrifié pour rembourser une dette » auprès d’un autre grand sorcier, radotaient les spécialistes de potins de chaumière.
Il a fallu la mort d’un homme dans un village voisin, dans des conditions quasi-similaires que Hawa, pour que l’on comprenne le mobile de la disparition de celle-ci. Un mois jour pour jour après son décès, l’homme succomba d’une morsure d’araignée (au village, on dit que l’araignée lui a pissé dessus ). Or, cet homme était soupçonné d’avoir eu une aventure éphémère avec la défunte Hawa à la beauté irrésistible. « Satigui s’est vengé », accusa-t-on…
Ces faits tragiques et étranges étaient autant de preuves de la sorcellerie du redouté Satigui. Ils étaient régulièrement rappelés en guise de mise en garde à l’endroit d’incrédules comme moi. Au final, j’avais plus peur d’être vu en sa compagnie que de ses pouvoirs maléfiques.
Je m’étais introduit subrepticement dans la maison de Satigui. En dépit de l’heure tardive, – il devait être une heure du matin – j’étais passé par des chemins complexes et tortueux de peur d’être remarqué par quelqu’un qui saurait ainsi que je fréquentais nuitamment le vieux sorcier. Nous étions assis autour du feu qui crépitait au milieu de la case, la porte négligemment entrebâillée. Dehors, le calme de la nuit noire n’était perturbé que par le croassement d’une bande de grenouilles qui faisaient un tintamarre agaçant.
L’ombre de la silhouette frêle de Satigui dansait sur le mur circulaire de la case, dessinée par la flamme vacillante alimentée par quelques bûchers et des copeaux secs. Son visage osseux était orné de deux renfoncements dans lesquels étaient logés ses petits yeux presqu’invisibles. De ses trente-deux dents d’adulte, il ne lui restait qu’une seule incisive du bas que l’on apercevait quand il riait. Ce qui était particulièrement rare. Il avait des oreilles de lapin aux lobes tombants dont l’un, celui de gauche, portait un anneau d’argent. Satigui arborait également au cou une sorte de pendentif constitué d’un fil rouge portant une longue dent d’animal qui pourrait être celle d’une panthère.
Satigui fut, en effet, un chasseur de grande renommée. Était-ce là l’explication de son amour immodéré pour la viande ?
Le vieux était un carnassier redoutable. Il bavait à la seule évocation d’un bon morceau de steak saignant. Satigui ne se fendait d’un léger sourire que lorsqu’il évoquait la chair ou quand il chiquait son tabac mélangé à de la cendre. Il était peu disert. Les rares fois qu’il parlait c’était pour narrer ses exploits épiques de chasseur, racontant par le menu un duel héroïque avec un buffle au cours d’une battue ou bien lorsqu’il rentrait à la maison, le cadavre d’une belle biche entre les épaules, trophée arraché en solitaire pour le grand bonheur de sa bien aimée Hawa. Les murs intérieurs de sa case étaient décorés de têtes d’animaux empaillées qui constituaient autant de preuves de sa bravoure et de ses talents d’ancien chasseur professionnel.
Bien qu’il ne pratiquât plus la chasse à 70 ans, handicapé par une vue légèrement décadente et des rhumatismes aux articulations, Satigui ne manquait pas pour autant de la viande ! Il en mangeait régulièrement. C’était sa nourriture principale. D’ailleurs sa vieille casserole noircie par la fumée était toujours posée au feu, mijotant de quelque morceaux de viande dont lui seul savait l’origine. Il en avait également disposée en lanières fumant au-dessus du feu pour une longue conservation.
Ce n’était pas pour rien que sa case était surnommée « l’atelier de la mort ». Bref, le mystérieux régime carné du vieux Satigui était savamment entretenu.
Satigui s’était aperçu de mon embarras en décrétant que tous les paiements de mes frais d’apprentissage se feront « en nature » et que ceux-ci seront « saignants ». Il en riait d’un rire sardonique. Il attendait mon acception pour sceller notre « pacte ». Je devais répondre immédiatement, puisque c’était notre troisième entretien privé. Il avait estimé que la confiance s’était suffisamment instaurée entre nous, même s’il me restait les épreuves de confirmation à surmonter.
J’hésitai un bon bout de temps entre m’engager sans savoir où cette expérience autant passionnante que terrifiante me mènerait, ou bien abandonner et retourner définitivement dans mes incertitudes. D’un coup, je répondis:
- Oui, j’accepte de relever le défi, comme je m’y suis déjà engagé. Je ne recule pas ! Dites-moi, qu’est-ce que je dois donner de « frais et saignant » pour mon inscription ?
Le vieux baissa la tête, réfléchit longuement, réajusta son collier dentelé avant de poser sur moi un regard inquisiteur.
- « Encore une fois, es-tu sûr de ton choix jeune homme ? » fit-il.
« Oui, je suis sûr », répondis-je dans un tremblement à peine dissimulé.
Alors voilà ce que tu dois me ramener dans trois jours maximum: la tête saignante d’un porc-épic et neuf de ses piquants !
Bien qu’un porc-épic ne fut pas un animal qu’on puisse croiser tous les jours, même au village, j’étais légèrement soulagé par cette exigence car je m’attendais à bien pire. Mais pourquoi diable, Satigui voulait uniquement la tête du porc-épic et neuf piquants et pas l’animal en entier ? La question me brulait les lèvres, mais je n’osai pas la lui poser.
Comment faire donc pour mettre main sur un porc-épic vivant que je devais tuer et décapiter pour ramener sa tête et neuf des ses piquants à l’Invincible ? En voici un grand défi.
Le lendemain, je passai toute la journée à réfléchir sur cette question. Je n’avais plus que 72 heures, tout au plus pour respecter l’échéance. C’était fort embarrassant puisque même au cours de mon enfance villageoise où mes amis et moi pratiquions la chasse et la cueillette, je n’ai jamais eu à faire avec un porc-épic, ce rongeur à la robe couverte de piquants repoussants. Le gibier que nous chassions était constitué d’oiseaux que nous abattions au lance-pierres ou d’écureuils que nous pourchassions dans les galeries et que nous enfumions pour les débusquer et les tuer à coups de bâtons.
Du porc-épic, j’entendais des récits étonnants. On racontait que quand il se sentait menacé, cet animal était capable de se contracter, puis de lancer vigoureusement ses piquants qui filaient à grande vitesse telles des sagaies pour transpercer l’ennemi. Rares sont donc les chasseurs qui osaient l’affronter, même armés d’un fusil de chasse.
L’affaire était mal embarquée pour moi. Rapidement, je réfléchis à deux options: m’en occuper moi-même ou faire appel au service d’un chasseur. La première option me garantissait une totale discrétion, puisque comme l’a insisté Satigui, personne ne devait être au courant de nos agissements et que si cela arrivait, il y mettrait immédiatement un terme et j’en paierais les « lourdes conséquences » selon ses propres termes ! Je me devais donc d’être d’une extrême prudence. La faiblesse de cette option est que je ne savais pas trop comment m’y prendre pour tuer le porc-épic. Avec le service d’un chasseur, je maximisais mes chances de réussite mais je courais le risque de l’indiscrétion.
Mes réflexions me conduisirent à une solution intermédiaire. Essayer moi-même d’abord et, en cas d’échec, faire recours à un chasseur.
Pour n’éveiller aucun soupçon, je choisis de poser un piège pour attraper le porc-épic au lieu de me servir d’un fusil. Je pouvais bien en emprunter un mais on allait non seulement me poser des questions mais je devais impérativement obéir à « la règle du quart » qui consistait à ramener au propriétaire de l’arme le quart du gibier abattu. Et impossible de se dérober, à chaque fois qu’un coup de fusil éclatait, tout le village était au courant de son auteur mais aussi de l’objet du tir dans l’heure qui suivait.
J’avais quelques connaissances rudimentaires de pose de piège. Dans mon enfance, il m’est arrivé de poser quelques pièges pour attraper des perdrix sauvages. Mes copains et moi, nous nous servions de deux types de piège: le noeud coulant à l’aide d’une simple ficelle et la catapulte. Le noeud coulant était discret et particulièrement efficace s’il était bien préparé. La catapulte était un peu plus sophistiquée. Elle était constituée d’une tige à laquelle est attachée une ficelle solide. Il fallait tendre la tige à l’aide de la ficelle, puis mettre en place un système de déclenchement au sol. On disposait des baies sauvages comme appât pour attirer le gibier qui se faisait ainsi prendre violemment en déclenchant le système. J’optai pour le noeud coulant.
Après quelques renseignements recueillis discrètement, je réussis à localiser une zone où il était possible de croiser des porcs-épics. Problème: la zone était éloignée du village, mais aussi très vaste. Je priai pour qu’elle soit entièrement habitée par le rongeur que je cherchais.
Je sélectionnai trois ficelles en sisal particulièrement résistantes. J’en fis des noeuds coulants et posai trois pièges distants d’une cinquantaine de mètres au milieu des fourrés dans une zone éloignée de plusieurs kilomètres du village. Avec un peu de chance, me dis-je, j’attraperai au moins un porc-épic. Je ramenai des bâtons de manioc hachés comme appât que je dispersai d’un côté et de l’autre de chaque piège. Je rentrai au village à la tombée de la nuit avec l’intention de revenir inspecter les pièges tôt le lendemain.
Me voici sur les lieux. Mon coeur bondit en apercevant l’animal qui se débattait au bout de la ficelle. L’un des pièges avait fonctionné. Je sortis le coutelas dont j’étais armé pour achever le porc-épic. Mais à mesure que je me rapprochais en prenant moult précautions pour éviter un éventuel lâcher de piquants, mon enthousiasme s’amenuisait. Le gibier au bout du fil n’était pas, hélas, un porc-épic, mais un malheureux lapin. Je le libérai et le regardai s’éloigner en boitant. Satigui exigeait un porc-épic, pas un lapin.
J’inspectai les deux autres pièges. Vides ! Je rentrai au village un peu déçu. Plus que 48H avant l’expiration du délai, il fallait mettre en oeuvre le plan B.
Sana, le chasseur ne me posa pas beaucoup de questions lorsque je lui fis cas de mon désir, celui de trouver d’urgence un porc-épic. Il exigea simplement le prix de la cartouche de chasse. Il me rassura qu’il savait où trouver des porcs-épics, mais ne me garantis pas de pouvoir m’en ramener un au bout de seulement 48H. Pourtant, le délai était de rigueur et j’insistai sur ce point. Compte tenu de l’urgence, Sana me réclama alors le prix de cinq cartouches m’expliquant qu’il était obligé de consacrer les deux nuits suivantes à cette quête. J’acceptai avec empressement.
Sana, un taiseux dans la quarantaine, était réputé être un chasseur adroit. Il pratiquait la chasse nocturne à l’affût et ne rentrait jamais bredouille. Petit-fils d’un ancien chasseur de renom, il utilisait un fusil de chasse artisanal hérité de son grand-père dont les munitions étaient constituées de cartouches de chevrotines. La cartouche contenait soit 9 balles de plomb pour le gros gibier, soit 25 balles pour les oiseaux et les petits rongeurs. Je lui donnai les cinq cartouches, deux de neuf balles et trois de 25 dans l’espoir de le revoir le lendemain avec le butin.
Tôt le lendemain matin, comme promis, Sana le chasseur me remit une petite besace noire en peau de boa. Quand je l’ouvris, je faillis perdre connaissance de stupéfaction : à l’intérieur, il y avait la tête saignante d’un porc-épic et exactement neuf piquants !
Je n’en revenais pas ! Il me fallut de longues minutes avant de reprendre mes esprits. Par quel miracle, Grand Dieu, Sana avait-il su que je voulais uniquement de la tête du porc-épic et de neuf piquants et non pas de l’animal tout entier ? J’ouvris et refermai le sac machinalement à plusieurs reprises sans pouvoir lui poser directement la question. Sana ne prononça que deux mots énigmatiques à mon endroit avant de tourner les talons: « bonne chance » éructa-t-il! J’étais dans la tourmente.
Comme d’habitude, j’avais rendez-vous avec Satigui au milieu de la nuit. Je passai toute l’après-midi à ressasser la même question: comment Sana avait-il pu être au courant de la requête du sorcier alors que j’avais pris toutes les précautions pour éviter de suspicion ? J’étais sûr que personne ne m’avait jamais suivi. Nul ne m’avait vu partir ou revenir de chez lui…
En l’absence de réponse à mes propres interrogations, il me vint à l’idée cette folle hypothèse: et si Sana était Satigui en réalité ? N’était-ce pas lui, le « grand-sorcier capable de diverses transmutations réversibles » ? Mais quelles seraient alors ses réelles motivations: jouer avec moi ? me démontrer ses pouvoirs occultes de manière spectaculaire ? D’ailleurs, avait-il était sincère avec moi en s’engageant à m’apprendre son « savoir » ? Une question chassait l’autre.
Satigui ne m’avait, certes, toujours pas dit quels allaient être les frais à payer à la fin de la formation, mais qu’importe. Pas question de renoncer, je remplirai ma part du contrat.
- « Bien » ! C’est le seul commentaire laconique que fit l’Invincible en inspectant le fond du sac que je lui remis tard la nuit chez lui, dans sa petite case fumante. Il sortit la tête du porc-épic et les neufs piquants qu’il examina longuement et compta consciencieusement. Il plaça son index sur le cou saignant de l’animal, le retira enduit de sang frais et le lécha avidement. Je frémis.
Je m’attendais à ce qu’il me demandât comment j’avais procédé pour ramener ce que je considérais comme un « trophée » tant il ne fut pas évident que je puisse réussir. Mais il ne dit mot en dehors de son « bien » lapidaire. Son attitude me rappela furtivement l’hypothèse selon laquelle Sana = Satigui…
Qu’allait-il faire de cette hideuse tête de porc-épic et de ces piquants ? Je n’allais pas tarder à le savoir en revenant chez lui, comme prévu, deux jours plus tard pour la nouvelle mission, le nouveau défi à relever. La tête du porc-épic vidée de sa cervelle et empaillée avait rejoint les nombreux trophées de l’ancien chasseur sur le mur intérieur de sa maison. Satigui avait néanmoins pris soin de la mettre légèrement à l’écart. Quant aux piquants, il les avait fichés dans une petite calebasse en deux cercles concentriques de quatre piquants chacun plaçant le neuvième piquant au centre du double-cercle. Je ne posai aucune question.
Satigui m’exposa les détails de la nouvelle mission à accomplir. De loin la plus redoutable pour moi.
- « Jeune homme », dit-il sans me jeter le moindre regard, « la tâche que vous allez exécuter vous permettra de faire preuve davantage de courage ».
- « D’accord », fis-je sans assurance. Il faut dire que la scène avec Sana me traumatisait toujours.
- « La calebasse que vous voyez-là, précisa-t-il, en désignant le récipient contenant les neuf piquants, vous allez la déposer à Bêly au tiers de la nuit, au creux d’un arbre que vous trouverez au bout de la piste qui y mène. Au pied de l’arbre, vous devriez trouver, en cherchant, une clé en or contenue dans un canari. Vous devez me rapporter cette clé ».
Le mot « Bêly » à lui seul hérissa mes poils. À l’enfance, cet endroit sinistre fut pendant très longtemps notre hantise mes copains d’âge et moi. On nous menaçait de nous jeter à Bêly pour nous punir de nos bêtises. La nuit suivante nous en faisions de tonnes de cauchemars.
Bêly était une mare située dans une sorte de clairière à environ trois kilomètres du village. L’endroit était considéré comme la capitale de tout ce que la contrée comptait de diables, de sorciers et autres esprits maléfiques. Pour y accéder, il fallait emprunter un sentier qui traverse le cimetière du village situé lui-même dans une forêt luxuriante et inextricable. Je devais donc déposer la calebasse des piquants à Bêly à deux heures du matin, chercher et trouver une clé de cadenas en or ! Même dans Koh-Lanta, je n’avais vu un numéro aussi difficile et effrayant. Mais il fallait s’y plier.
Un pantalon jean et des bottes en plastique pour parer à une éventuelle morsure de scorpion ou de serpent. Ce fut tout mon équipement. Je me présentai chez Satigui la nuit à deux heures et quart en prenant toutes les précautions d’usage. Il me remit la calebasse recouverte d’un morceau de tissu blanc. Du linceul ? Pour m’éclairer le chemin, le vieil homme sortit un vieux fanal recouvert de suie qu’il dégagea en soufflant dessus. Il alluma la lampe avec grand-peine et me la tendit. Avant mon départ, Satigui me répéta pour la énième fois deux consignes fermes: ne jamais me retourner après avoir déposé la calebasse dans le creux de l’arbre et pris la clé, ne jamais soulever le couvercle pour tenter de découvrir la contenance.
- « C’est promis » parvins-je à marmonner, étreint par l’angoisse, avant de m’emparer de la lampe et la calebasse que je plaçai sous mon aisselle gauche.
- « Bonne chance » me lança Satigui, l’air insouciant. Je ne répondis pas.
Il faisait une de ces nuits noires. Tout le monde dans le village dormait à poings fermés. Seuls les animaux, et sans doute les esprits, restaient maîtres de la nuit. Aux alentours de la maison du sorcier, le concert de grenouilles qui tenait Satigui compagnie chaque nuit, plus loin les hululements lugubres d’un hibou renchéris par les aboiements d’une meute de chiens errants.
Je m’engageai sur l’étroit sentier le cœur battant la chamade. Je marchais d’un pays hâtif dans l’espoir d’arriver rapidement à Bêly, déposer la calebasse, ramasser la clé et rentrer au village sans me retourner. La forêt grouillait de mille bruits. À mesure que je m’éloignais, les cris d’animaux sauvages se faisaient plus nombreux et plus effrayants. De temps en temps, un oiseau au vol lourd changeait d’arbre me poussant à marquer une petite halte pour écouter. Puis, je repartais avec un nouvel empressement.
Sous la lumière blafarde de la lampe-tempête, je marchai ainsi dans la forêt depuis une bonne trentaine de minutes. Je ne voyais pas au-delà de cinq mètres. Le sentier devenait de plus en plus étroit, envahi par les herbes et les branchages. Je traversai le cimetière avec moins de crainte que je l’imaginais en me disant que c’étaient mes semblables qui reposaient-là. Je formulai même intérieurement une prière pour le repos de leurs âmes.
C’était sans doute sous l’effet de la peur et du stress, mais j’avais l’impression que l’on me suivait. Je ne voyais plus grand-chose tellement la forêt devenait dense et touffue. Je perdis mon chemin, m’égarant un long moment avant de me retrouver et de continuer la route.
Je finis par arriver à destination. L’arbre correspondait point pour point à la description de Satigui. C’était un immense fromager centenaire dressé aux abords de la mare aux eaux saumâtres. Il avait un large creux sur son tronc à hauteur d’homme. Je hissai le fanal au-dessus de ma tête pour mieux visualiser le trou. Au moment de déposer la calebasse, un animal sauta du creux, manquant de me renverser, se dressa sur ses pattes arrières, poussa un cri glaçant avant de détaler ! Je fus saisi d’effroi, mais je reconnus tout de suite un chacal dérangé dans son sommeil. Il fallait poursuivre la mission.
Je déposai la calebasse, tremblant de la tête aux pieds. J’étais tellement pressé de quitter les lieux que je faillis oublier de retrouver le canari contenant la clé. Je me mis à chercher autour du fromager. Au bout d’un quart d’heure qui me parut interminable, je tombai sur un petit canari à environ cinq mètres de l’arbre, posé au milieu de trois grosses pierres. Sans vérifier s’il contenait la clé, je le pris en poussant un ouf de soulagement imperceptible.
Je repris immédiatement le chemin de retour sans me retourner. Or, cette fois quelqu’un me suivait ! Je le sentais. J’en avais la certitude. Je pressai le pas. Soudain, une voix d’homme me donna clairement l’ordre de m’arrêter et de me retourner. J’étais pétrifié ! Fallait-il obéir et violer ainsi la mise en garde de Satigui ? Était-ce lui ou un diable ? J’hésitai un bref instant avant de décider d’ignorer l’ordre et de continuer mon chemin. C’est alors que je sentis le métal froid d’un canon de fusil sur ma nuque!
« Si tu fais un seul pas de plus, je tire » tonna la voix ! Je m’arrêtai net et me retournai, me retrouvant nez à nez avec … Sana le chasseur !
Le choc fut si intense que le canari s’échappa de mes mains, tomba et se brisa en mille morceaux ! Équipé d’une lampe-torche accrochée à sa tête à l’aide d’un élastique, Sana se mit à chercher par terre avec frénésie. Il m’ordonna de l’aider à retrouver « le cadenas »! On chercha en vain. Le canari était manifestement vide de tout objet ! En désespoir de cause, Sana retourna toutes mes poches, une à une. Vides ! Il sortit la calebasse que j’avais déposée quelques minutes plus tôt dans le creux de l’arbre, l’inspecta. Elle était complètement vide. Pas même l’ombre d’un seul piquant à mon grand étonnement ! Il la jeta par terre, marcha dessus, la brisa avant de disparaître dans la forêt en courant, sans rien me dire de plus.
Je repris le chemin du village au pas de course, sans me soucier des épines qui me laceraient le corps. L’enchainement des évènements me dépassait. J’appréhendai la rencontre avec Satigui à qui je ne pouvais plus continuer à cacher la vérité. Il fallait lui dire que Sana savait tout et même bien plus que nous ne pouvions l’imaginer. Enfin, si Sana était vraiment Sana. Je rentrai au village aux aurores, totalement méconnaissable. Mes vêtements étaient en lambeaux. Je saignais des mains, des avant-bras et du visage, la peau coupée par les épines et les lianes.
Le visage du vieil homme se décomposait à mesure que je lui narrais ma mésaventure. Satigui était ivre de rage. À un moment, je crus qu’il allait se métamorphoser en un animal féroce pour me dévorer, tant il s’agitait et hurlait. Curieusement, il n’était pas en colère contre moi, mais contre « Sana le bâtard » comme il qualifia le jeune chasseur.
En voyant le dépit maladif de Satigui, j’osai pour la première fois l’interroger ouvertement sur le sens de différentes missions mystérieuses qu’il m’avait confiées. Je voulais connaitre la suite de notre collaboration et quand est-ce qu’il m’apprendrait « sa science ».
- « Tu n’as pas réussi à rapporter la clé permettant d’accéder à la science que toi et moi cherchons » me répondit-il plus énigmatique que jamais ! J’étais ébahi. Quelle science lui et moi cherchions ? N’était-ce pas moi l’apprenti, lui le maître ?
C’est alors que Satigui se leva, prit un bout de métal rouillé et alla creuser dans un coin de sa case d’où il sortit, enfoui dans le sol, un talisman. Il s’agissait d’un cadenas fermé, cousu dans du cuir poilu serti de deux cauris.
« La clé de ceci » dit-il en secouant le cadenas tenu à bout de bras. « Elle est dans la forêt, au pied du grand fromager. Je suis sûr que la clé en or s’y trouve », répéta-t-il, comme pour se convaincre lui-même de cette vérité. « Hélas, je n’ai plus la force d’y aller et la vue nécessaire me permettant de la chercher et de la retrouver » se lamenta Satigui.
J’étais perdu !
On sentait le jour poindre à travers les fentes de la porte d’entrée de la case. Pour la première fois, je me retrouvai chez le vieil homme pendant le jour. Satigui sortit et m’invita à le suivre dehors. Il m’entraina derrière sa maison dans un endroit boisé. Il y avait un grand trou et une petite porte en bois qu’il poussa. On se retrouva dans un étroit tunnel obscur. Le sol craquait sous nos pieds. Quand il alluma une torche en bois, je découvris un spectacle effarant: le sol était littéralement recouvert d’os et de têtes de mort ! Des rats ! Des dizaines et des dizaines de rats morts et vivants. Ça courait dans tous les sens. Certains agonisaient encore sur les nombreux pièges que Satigui avait installés dans le tunnel. L’endroit était puant et horrible.
« Voilà ma nourriture », dit Satigui d’une voix chevrotante, en désignant les rongeurs piégés!
« Nom de Dieu » …, m’écriai-je, abasourdi !
Le vieil homme me tira dehors. On regagna sa maison où il prit place sur une peau de bélier tannée. Il regarda fixement dans le vide comme quelqu’un qui voulait se remémorer du passé. Je sentis qu’il avait quelque chose d’important à me raconter.
« Mon fils » entama Satigui, m’appelant ainsi pour la première fois depuis notre toute première rencontre. « L’apparence est trompeuse », poursuivit-il, un vague à l’âme. Ce que je vais te raconter-là, je ne l’avais dit à personne, même pas à ma femme Hawa…
Satigui parla longtemps, s’humectant régulièrement les lèvres d’un étrange breuvage contenu dans une petite fiole. Le soleil était déjà au zénith quand il acheva son récit digne d’un conte de fée. Il m’étala tout ce que j’ignorais jusqu’ici. À présent, tout était clair pour moi parce qu’il s’était entièrement livré. J’étais pleinement reconnaissant devant tant de sincérité et de confiance.
Satigui m’expliqua que cela faisait près d’un quart de siècle qu’il était à la recherche d’une clé en or pour ouvrir le cadenas qu’il venait de déterrer. Ce cadenas avait appartenu à Sabali, le grand-père de Sana le chasseur. Sabali était connu pour être un chasseur de renom doublé d’un redoutable sorcier. Satigui fut son disciple pour la chasse et les deux hommes entretinrent de solides liens d’amitié et de complicité pendant plusieurs années avant de se brouiller pour une raison inconnue du public. Comme Satigui, Sabali perdit son unique fils, le père de Sana, à bas-âge.
Avant de mourir à son tour, Sabali plaça tout son savoir occulte dans un cadenas qu’il ferma à l’aide d’une clé en or. Il confia les deux objets à sa femme, Rassy, avec pour consigne de les remettre à son petit-fils qu’elle élevait, une fois que celui-ci deviendrait suffisamment grand.
Quiconque réussirait à ouvrir ce cadenas, disait-on, posséderait toute la « science » de Sabali qui vécut heureux et opulent sur le plan matériel. Satigui qui connaissait l’existence de ce secret, voulait à tout prix y mettre main.
Seulement voilà. La vieille Rassy sépara le cadenas de la clé pour mieux les sécuriser. Elle cacha le cadenas dans le creux du fromager, loin du village, ne se doutant pas que Satigui en chasse dans la zone de Bêly ce jour-là l’avait filée et repéré la cachette. Il fouilla la zone pendant des jours avant de découvrir le cadenas qu’il subtilisa pour aller l’enfouir dans sa case. Mais il ne retrouva jamais la clé, malgré des années de recherche. Personne ne savait où elle se trouvait.
Personne, sauf Sana le chasseur qui, plusieurs années après la disparition de sa grand-mère, avait découvert la clé un peu par hasard en creusant une termitière qui rongeait la clôture de sa maison. De son vivant, Rassy lui fit cas de l’existence d’un « trésor caché », mais il n’y prêta guère attention, la vieille ayant perdu la tête avant de mourir.
Par la suite, Sana soupçonna Satigui de détenir le cadenas, se souvenant de la proximité douteuse du vieux loup solitaire avec sa grand-mère. En réalité, Satigui et Rassy, tous deux veufs, fricotèrent ensemble un moment, ravivant la flamme d’une amourette de jeunesse interrompue par le mariage précoce de Rassy à Sabali. Satigui s’était en effet juré de prendre, tôt ou tard, sa revanche sur ce briseur de cœur. D’où le surnom fanfaron de « l’Invincible » dont il s’attribua…
Des années plus tard, un évènement inattendu conforta le jeune Sana dans ses soupçons sur la culpabilité de sorcellerie de Soro-Satigui. En effet, des soi-disant exorcistes débarquèrent dans la contrée avec comme pour mission de dénicher et de « délivrer tous les sorciers ». Ils organisèrent un grand spectacle de danse mystique au cours duquel ils désignèrent plusieurs personnes âgées comme étant des sorciers. Parmi elles, le chasseur Satigui Barry. Cette dénonciation ajoutée à la mort accidentelle de son fils et de sa femme acheva de conforta tout le village qu’il était un redoutable sorcier.
Calomnié et affaibli par le poids de l’âge, Satigui joua le jeu et accepta avec résignation son sort malheureux en menant une vie de bernard-l’hermite et du plus grand mangeur de rats, faute de moyens. Mais il ne perdit jamais espoir.
En venant lui demander de m’apprendre la sorcellerie, Satigui saisissait ainsi une chance inespérée de retrouver la clé du cadenas qu’il avait tant cherchée. Sans doute la clé du bonheur pour lui. Pour cela, il comptait sur ma motivation et ma détermination. D’où les épreuves auxquelles il m’avait soumis. Il me révéla que la première épreuve, celle de la tête du porc-épic, était une simple diversion. Il voulait s’assurer de mon réel engagement. Et les neufs piquants donc ?
Satigui m’avoua qu’il n’avait besoin que d’un seul en réalité dont il se servirait pour faire sortir le « mauvais sang » de son nez quand la tête lui faisait mal. Ce qui était récurrent. Les huit autres, c’était pour compliquer ma tâche et s’assurer que je n’avais pas ramassé l’unique piquant par hasard.
Sana espionnait Satigui depuis très longtemps, à l’affût du moindre indice lui permettant de savoir s’il était le détenteur du cadenas légué par son aïeul. Son trésor à lui. Mon arrivée au village ne l’échappa guère. Il m’avait discrètement filé dans mes moindres déplacements, écoutant toutes mes conversations avec Satigui. C’est ainsi qu’il fut au courant de différentes missions qu’il tenta d’exploiter en sa faveur.
Le récit du vieil homme m’émut aux larmes. Je lui exprimai à nouveau ma sympathie et mon amitié. J’étais venu auprès de lui pour vérifier l’existence de la sorcellerie, je repartais avec une véritable leçon de vie, celle de l’humilité et de la méfiance des préjugés. Je fis mes adieux à Satigui Barry et sortis de sa maison le cœur noué. Sana était assis dehors, vautré sur la palissade de la case, en proie à des sanglots spasmodiques !
Alimou Sow, octobre 2018 (ceci est une fiction)
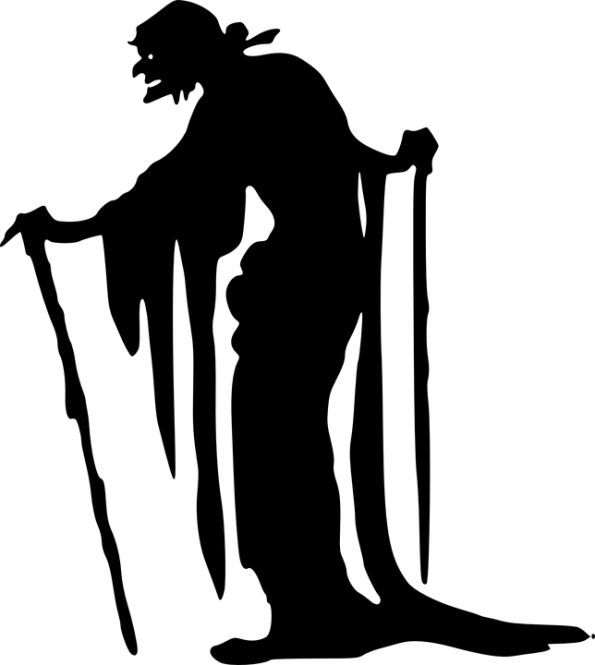
Commentaires